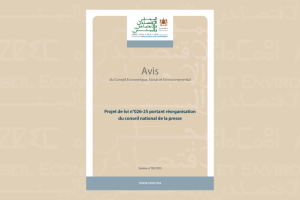
Le CESE a été saisi par la Chambre des représentants, le 16 juillet 2025, aux fins d’émettre un avis sur le «projet de loi n°026-25 portant réorganisation du Conseil national de la presse». Élaboré sur la base d’une approche participative, l’avis est le résultat d’un large débat entre les différentes catégories du Conseil et d’auditions organisées avec les principales parties prenantes concernées. Il a été adopté à la majorité par l’assemblée générale du Conseil, tenue le 25 septembre 2025.
L’autorégulation du secteur de la presse et de l’édition au Maroc, incarnée par une institution indépendante et élue, constitue une avancée majeure pour la protection des droits et libertés. En effet, la Constitution du Royaume, dans son article 28, stipule que « la liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable ».
Le Maroc a été l’un des pays arabes et africains pionniers à adopter ce mécanisme, en créant le Conseil national de la presse (CNP), chargé notamment de promouvoir l’éthique journalistique et d’accompagner le développement du secteur dans un cadre autonome, indépendant et démocratique.
A l’issue du premier mandat du CNP, ses instances n’ont pas pu être réélues en raison de l’absence, dans le texte de création, d’une disposition précisant expressément l’autorité chargée de convoquer les élections. Face à cette situation, le département chargé de la communication a jugé nécessaire d’abroger la loi en vigueur et de soumettre le projet de loi n°026-25 visant à réorganiser ledit Conseil.
À l’examen de ce projet de loi, objet de la saisine, le CESE relève que certaines dispositions suscitent encore un ensemble d’interrogations, notamment :
- la suppression dans la composition de l’institution des représentants de la société civile ou du public ;
- une asymétrie dans les modalités de désignation des membres, avec un vote pour les journalistes et une désignation pour les éditeurs ;
- un déséquilibre numérique entre représentants des éditeurs (9) et ceux des journalistes (7) ;
- une attention excessive portée aux sanctions disciplinaires, alors même que les notions de faute professionnelle et de violation de la charte d’éthique ne sont pas explicitées et que la nécessaire mission de médiation entre professionnels n’est pas suffisamment mise en avant.
En outre, le Conseil relève que le projet de loi ne prend pas valablement en compte les transformations économiques et technologiques affectant le secteur de la presse écrite, fragilisé par la crise sanitaire et la concurrence des plateformes numériques et des réseaux sociaux.
À ce titre, le CESE estime que la poursuite des échanges et consultations avec les parties prenantes concernées ferait émerger un consensus beaucoup plus abouti autour d’un texte permettant au CNP de disposer des voies et moyens pour exercer, de manière efficace, pertinente et inclusive, ses missions fondamentales d’autorégulation et de médiation.
Partant de ces constats partagés avec les parties prenantes auditionnées, le CESE formule un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles il est permis de citer :
- Renforcer la représentation du public au sein du CNP, en maintenant la présence du Conseil national des langues et de la culture marocaines, de l’association des barreaux du Maroc et de l’union des écrivains du Maroc et en intégrant des représentants d’associations de protection des droits des consommateurs.
- Ajouter une quatrième catégorie au CNP, dite celle des « Sages », composée de deux éditeurs et de deux journalistes sélectionnés selon des critères objectifs. Cette mesure permettrait de préserver l’équilibre numérique entre journalistes et éditeurs, dans le respect de la philosophie de l’autorégulation appréhendée en tant que mécanisme « d’arbitrage par les pairs », en vue de conférer neutralité, impartialité et, in fine, légitimité au processus décisionnel.
- Adopter, s’agissant des journalistes, un mode de scrutin de liste à représentation proportionnelle aux fins d’assurer une représentation reflétant le pluralisme et la diversité du corps journalistique.
- Appliquer un mode unifié de scrutin aux représentants des éditeurs, en établissant des critères objectifs et opposables de candidature (quantitatifs et qualitatifs), dans le sens d’un pluralisme et d’une représentation inclusive des petits éditeurs.
- Renforcer les mécanismes de médiation et d’arbitrage, afin de limiter autant que possible le recours aux sanctions disciplinaires à l’encontre des journalistes et des entreprises de presse, tout en apportant une caractérisation explicite de la notion de faute professionnelle.
- Accélérer l’élaboration ou la mise à jour de la charte d’éthique professionnelle, en veillant à associer toutes les catégories représentées au CNP, aux fins de clarifier les concepts en lien avec les violations de ladite charte.
- Envisager un élargissement des missions du CNP pour lui permettre de: i) réaliser des études prospectives sur le devenir du secteur de la presse face aux mutations induites par les outils de l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux ; ii) œuvrer pour l’amélioration de la situation sociale et économique des journalistes dans le cadre du dialogue social sectoriel ; iii) s’ouvrir aux créateurs de contenus, influenceurs et « citoyens-journalistes », à travers des programmes de sensibilisation, de formation continue et d’encadrement pour promouvoir le respect des règles déontologiques et partant de contribuer à la création d’un contenu crédible et de qualité.
Le CESE est fermement convaincu de l’importance de la réorganisation du CNP compte tenu de son rôle central dans l’autorégulation du secteur. Pour assurer à la fois la continuité institutionnelle et répondre à l’impératif de réforme, le CESE estime qu’il aurait été préférable de se limiter dans un premier temps à des ajustements relatifs à l’organisation des élections, tout en engageant des consultations élargies pour préparer une réforme globale et concertée de l’ensemble des textes constituant le code de la presse et de l’édition (lois relatives au CNP, au statut des journalistes professionnels, à la presse et à l’édition). Ces textes, interdépendants par essence, nécessitent une révision simultanée afin d’accompagner les évolutions normatives en matière de libertés de pensée, d’expression et d’opinion, tout en répondant aux défis auxquels la presse est confrontée, qu’il s’agisse des exigences déontologiques ou de soutenabilité économique des entreprises éditrices.
