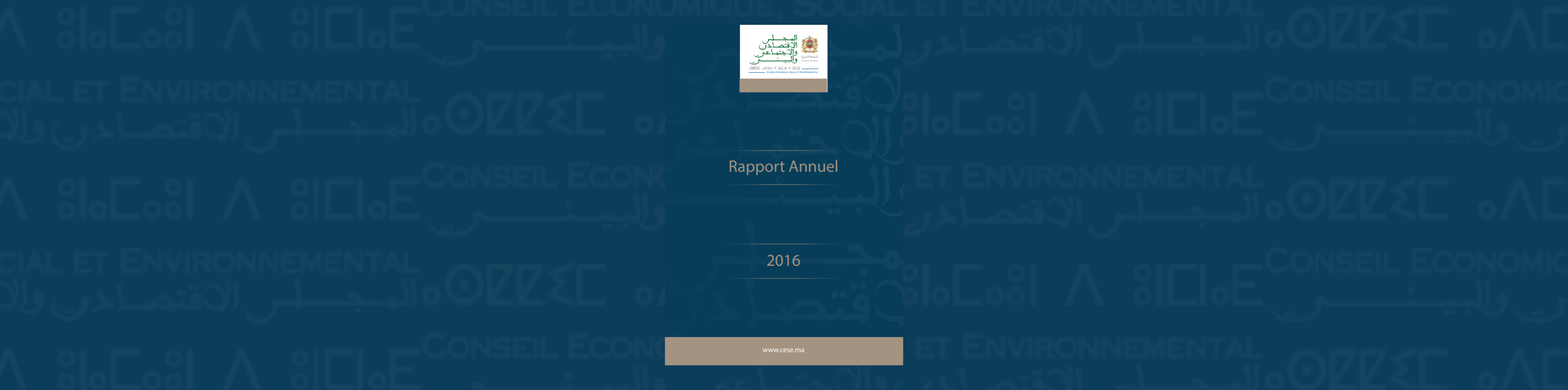
Elaboré conformément à la loi organique régissant le Conseil économique, social et environnemental, ce rapport comporte une analyse de la situation économique, sociale et environnementale au Maroc en 2016, de même qu’il procède à une revue de l’activité du Conseil au titre de la même année.
Le Conseil procède ainsi à une analyse des principales évolutions sur les plans économique, social et environnemental et émis des recommandations en mettant l’accent sur quelques points de vigilance identifiés.
S’agissant du Focus du rapport de 2016, et eu égard au potentiel que représente le digital comme canal d’amélioration du service au citoyen, mais également comme moyen efficace de lutte contre la corruption au niveau des services publics, le Conseil recommande d’élaborer une démarche globale et cohérente pour un nouveau palier de la digitalisation des services publics. Cette orientation devrait permettre d’assurer l’équité, la transparence et l’efficience au niveau du service offert au citoyen à travers notamment la concrétisation de la Charte des services publics prévue par la Constitution et la mise en place d’une structure de pilotage institutionnel forte et dédiée.
Dans la troisième partie du rapport annuel, le Conseil présente son rapport d’activité pour l’année 2016 ainsi que son plan d’action au titre de l’année 2017.
Elaboré conformément à la loi organique régissant le Conseil économique, social et environnemental, ce rapport comporte une analyse de la situation économique, sociale et environnementale au Maroc en 2016, de même qu’il procède à une revue de l’activité du Conseil au titre de la même année.
Le Conseil procède ainsi à une analyse des principales évolutions sur les plans économique, social et environnemental et émis des recommandations en mettant l’accent sur quelques points de vigilance identifiés.
Sur le volet économique, le rapport relève que le contexte international a été marqué, en 2016, par un ralentissement de la croissance mondiale, une poursuite du mouvement de décélération du commerce mondial, une orientation protectionniste de quelques pays avancés et émergents, ainsi qu’un rééquilibrage continu de l’économie chinoise.
Au niveau national, l’année 2016 s’est caractérisée par de faibles performances. En effet, la croissance du PIB a enregistré un ralentissement notable, à 1,2%, après 4,5% en 2015, suite à une contraction de la valeur ajoutée agricole, en raison d’un déficit pluviométrique, jugé le plus sévère en trente ans, alors que la valeur ajoutée non agricole a évolué à un rythme très modéré. Cette évolution confirme la vulnérabilité de l’économie marocaine aux aléas climatiques, qui s’avère, toutefois, moins importante comparativement au passé.
Dans ce contexte, 37 000 emplois ont été perdus en 2016, dont une grande partie dans le secteur agricole. Sur cet aspect, les évolutions du marché du travail en 2016 n’ont fait que corroborer l’idée qu’en plus des facteurs conjoncturels, la faiblesse de la création d’emploi au Maroc revêt un caractère structurel qui s’accentue dans le temps. Par ailleurs, les catégories qui ont pâti davantage de la morosité du marché du travail sont essentiellement les femmes et les jeunes, en particulier parmi les diplômés.
Concernant les équilibres macroéconomiques, l’année 2016 a connu des évolutions mitigées, entre d’une part, la poursuite de la résorption du déficit budgétaire et d’autre part, le creusement du déficit commercial, la détérioration du taux de couverture des importations et le recul des flux entrants d’IDE.
A la lumière de ces évolutions, le Conseil Economique, Social et Environnemental recommande que l’orientation des politiques publiques, à l’heure actuelle, puisse éviter l’érosion de la demande domestique, étant donné ses effets stabilisateurs, et ce dans le cadre d’une politique contra-cyclique de stabilisation qui pourrait soutenir le pouvoir d’achat. Il s’agit, également, de mettre en place des mécanismes pour réduire la volatilité des revenus des ruraux en finançant des portefeuilles de projets non agricoles en milieu rural de nature à créer des emplois et une demande locale durant les mauvaises campagnes.
Parallèlement, il est préconisé de soutenir l’élargissement de la base productive nationale, en termes de nombre d’entreprises créées, pour compenser le caractère intensif en capital des nouveaux secteurs et créer des emplois de qualité en nombre suffisant.
Sur ce même volet, le Conseil recommande de promouvoir une économie bleue intégrée qui va au-delà du secteur de la pêche, et qui se base sur une exploitation optimale des ressources maritimes dans différents secteurs liés à la mer (industrie navale, valorisation des algues, exploitation des ressources off-shore…), parallèlement au développement de la R&D et de formations adaptées aux différents métiers de ce secteur.
Sur le plan social, le Conseil relève une poursuite des dysfonctionnements structurels qui entravent la mise à niveau des secteurs sociaux. Cela s’est traduit dans le secteur de l’éducation, par l’aggravation du surpeuplement des classes, la persistance de l’abandon scolaire et le recours hâtif au recrutement des enseignants pour combler le déficit constaté. De même, le rapport met l’accent sur les répercussions négatives potentielles que pourraient avoir le recours à l’instauration de frais d’enregistrement au niveau des écoles publiques, ainsi que l’orientation progressive des familles pauvres, modestes et moyennes vers les écoles privées. Afin de pallier ces problèmes au niveau du secteur, le Conseil recommande, entre autres, (i) d’encourager les régions à jouer un rôle plus important dans l’éducation, notamment en matière de financement ou en participant au contrôle de la gestion administrative des établissements scolaires, (ii) ainsi qu’une meilleure implication des associations de représentants des parents et de la société civile, dans la formulation des propositions, des orientations et l’évaluation du système éducatif et ce, dans le cadre d’un processus institutionnalisé et régulier.
Dans le secteur de la santé, des avancées ont certes été enregistrées, notamment dans la généralisation de la couverture médicale de base. Toutefois, le secteur reste en proie à de nombreux déficits liés principalement à l’insuffisance de l’offre de soins dans les structures publiques. Ainsi, le conseil appelle à mettre en place les mécanismes de financement nécessaires pour réaliser un accès plus large et de meilleure qualité aux soins, une répartition territoriale équitable dans le cadre d’une carte sanitaire opposable et une gestion efficace du personnel de soins.
Sur le plan de l’égalité de genre et des droits des femmes, un retard a été déploré dans la mise en œuvre des mesures prévues par la Constitution pour la réalisation de l’égalité effective. Le Conseil appelle à la mise en place d’une stratégie volontariste visant l’amélioration des conditions des femmes ainsi qu’à l’adoption de textes juridiques plus sévères et une application plus rigoureuse de la loi concernant le mariage des mineures.
Sur le plan Environnemental, le Conseil relève une persistance du coût élevé de dégradation de l’environnement, en dépit d’une légère atténuation par rapport au début des années 2000. De même, le rapport a mis l’accent sur la menace du stress hydrique auquel notre pays est exposé et qui requiert des mesures urgentes et bien ciblées sur le territoire national. Dans ce sens, le Conseil préconise d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour le Développement Durable et de poursuivre les efforts engagés en matière de gestion des ressources hydriques dans les zones les plus vulnérables à la sècheresse. Par ailleurs, le Conseil appelle à une meilleure prise en considération du risque climatique dans la planification urbaine et ce, notamment au niveau des documents d’urbanisme, des plans d’aménagement urbain et des plans de déplacement urbain.
S’agissant du Focus du rapport de 2016, et eu égard au potentiel que représente le digital comme canal d’amélioration du service au citoyen, mais également comme moyen efficace de lutte contre la corruption au niveau des services publics, le Conseil recommande d’élaborer une démarche globale et cohérente pour un nouveau palier de la digitalisation des services publics. Cette orientation devrait permettre d’assurer l’équité, la transparence et l’efficience au niveau du service offert au citoyen à travers notamment la concrétisation de la Charte des services publics prévue par la Constitution et la mise en place d’une structure de pilotage institutionnel forte et dédiée.
Dans la troisième partie du rapport annuel, le Conseil présente son rapport d’activité pour l’année 2016 ainsi que son plan d’action au titre de l’année 2017.
